Tensions entre Telegram et la France autour des lois européennes
Dans un monde où l’information se mêle souvent à la désinformation, Telegram, l’application de messagerie cryptée, s’est retrouvée au centre d’une polémique inédite. Alors que la France affirme avoir contraint la plateforme à respecter les règles européennes après l’arrestation de son fondateur, Pavel Durov retourne l’accusation : selon lui, ce sont les autorités françaises qui ont tardé à appliquer les procédures prévues par l’UE. Un duel rhétorique qui révèle des tensions plus profondes sur le contrôle des géants tech.
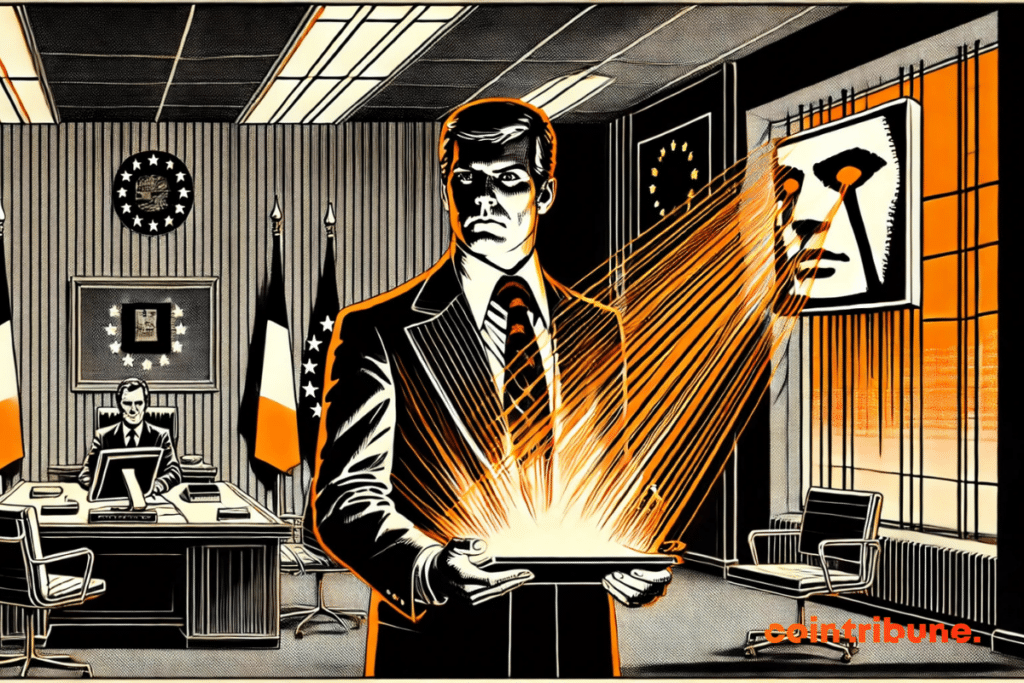
En bref
- Telegram au cœur d’une polémique après l’arrestation de son fondateur, Pavel Durov, en France.
- Paris se félicite d’avoir forcé la plateforme à se conformer au Digital Services Act.
- Durov rétorque : Telegram était déjà conforme, ce sont les autorités françaises qui ignoraient les procédures.
- Une affaire qui met en lumière les lacunes administratives et les tensions autour de la régulation numérique européenne.
Chronologie d’un malentendu : arrestation, procédures et récits contradictoires
L’été 2024 restera marqué par l’interpellation spectaculaire de Pavel Durov en France. Accusé de complicité dans des affaires d’exploitation infantile et de trafic de stupéfiants – des allégations liées à la modération jugée laxiste sur Telegram –, le fondateur est placé en garde à vue, puis libéré sous contrôle judiciaire. Les médias français relaient alors une version officielle : cette arrestation aurait incité Telegram à enfin coopérer avec les exigences européennes.
Mais Durov, habitué aux prises de position tranchées, conteste fermement ce récit. Sur X (ex-Twitter), il dénonce une désinformation flagrante. Selon lui, Telegram respecte scrupuleusement le Digital Services Act (DSA) depuis des années, anticipant même son entrée en vigueur. « Nous consacrons des millions de dollars annuels à la conformité juridique, partout », martèle-t-il. L’arrestation, estime-t-il, sert de prétexte pour masquer les manquements français.
La preuve avancée ? Les autorités hexagonales n’auraient commencé à utiliser les canaux légaux du DSA qu’après l’incident. « Avant août 2024, elles ignoraient les procédures officielles pour nous contacter », explique Durov.
Une méthode pourtant décrite publiquement sur le site de Telegram, accessible via une simple recherche Google. Un détail qui jette une lumière crue sur les pratiques administratives françaises.
Le DSA, entre idéal réglementaire et réalités opérationnelles
Le Digital Services Act, pierre angulaire de la régulation numérique européenne, impose aux plateformes de collaborer avec les États membres via des processus stricts.
Telegram assure avoir joué le jeu dès le début : interface dédiée pour les requêtes judiciaires, équipes dédiées, transparence renforcée. « Nous sommes prêts des années avant les deadlines légales », insiste Durov.
Pourtant, la France aurait persisté à contourner ces outils. Jusqu’en 2024, les demandes d’accès aux données utilisateurs arrivaient par email, parfois sans mandat formel – une pratique incompatible avec le DSA. « Après mon arrestation, la police française a soudain découvert la procédure correcte », ironise le fondateur. Résultat ? Des tribunaux ont enfin pu obtenir des informations cruciales pour des enquêtes criminelles.
Cette volte-face interroge. Pourquoi un État membre, souvent perçu comme un moteur de l’UE, a-t-il mis autant de temps à appliquer ses propres règles ? Certains y voient une logique de pouvoir : en diabolisant Telegram, la France masquerait ses propres latences bureaucratiques. D’autres évoquent une méconnaissance des mécanismes techniques du DSA, complexe même pour les initiés.
Souveraineté numérique : qui contrôle vraiment l’espace en ligne ?
Au-delà du clash franco-Telegram, ce litige soulève une question cruciale : dans un monde interconnecté, qui détient l’autorité réelle sur les plateformes globalisées ? Les États-nations, malgré leurs lois, peinent à imposer leur volonté à des acteurs sans siège physique fixe. Telegram, basé à Dubaï, incarne cette fluidité géographique qui défie les juridictions traditionnelles.
La réponse européenne, via le DSA, vise à harmoniser les règles. Mais son application reste inégale. La France, en accusant Telegram de non-coopération, tente d’affirmer son leadership. Pourtant, les faits rapportés par Durov suggèrent un manque de préparation structurelle. « On ne peut exiger des entreprises qu’elles respectent des lois que les États eux-mêmes ignorent », résume un expert en droit numérique.
Cette affaire pourrait créer un précédent. Si les pays membres tardent à maîtriser les outils fournis par le DSA, les plateformes gagneront de facto un pouvoir normatif. Telegram, en dénonçant publiquement les erreurs françaises, renverse le rapport de force : c’est désormais à l’UE de prouver sa crédibilité régulatrice.
Le conflit entre Telegram et la France n’est pas qu’une querelle sémantique. Il symbolise les défis d’une régulation numérique encore balbutiante, où les principes se heurtent aux réalités opérationnelles.
Maximisez votre expérience Cointribune avec notre programme 'Read to Earn' ! Pour chaque article que vous lisez, gagnez des points et accédez à des récompenses exclusives. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à cumuler des avantages.

Fasciné par le bitcoin depuis 2017, Evariste n'a cessé de se documenter sur le sujet. Si son premier intérêt s'est porté sur le trading, il essaie désormais activement d’appréhender toutes les avancées centrées sur les cryptomonnaies. En tant que rédacteur, il aspire à fournir en permanence un travail de haute qualité qui reflète l'état du secteur dans son ensemble.
Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.