Les États-Unis saisissent 200 000 dollars en crypto liés au Hamas
La blockchain, souvent perçue comme une zone d’ombre propice aux activités illicites, vient de montrer son autre visage : une traçabilité implacable. En mars 2024, le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie de 201 400 dollars en crypto, liés au Hamas. Derrière ce coup d’éclat se cachent des enjeux bien plus vastes que la simple confiscation d’actifs. Entre régulation accrue et mythes à déconstruire, cette affaire soulève des questions cruciales sur l’avenir des financements terroristes à l’ère numérique.
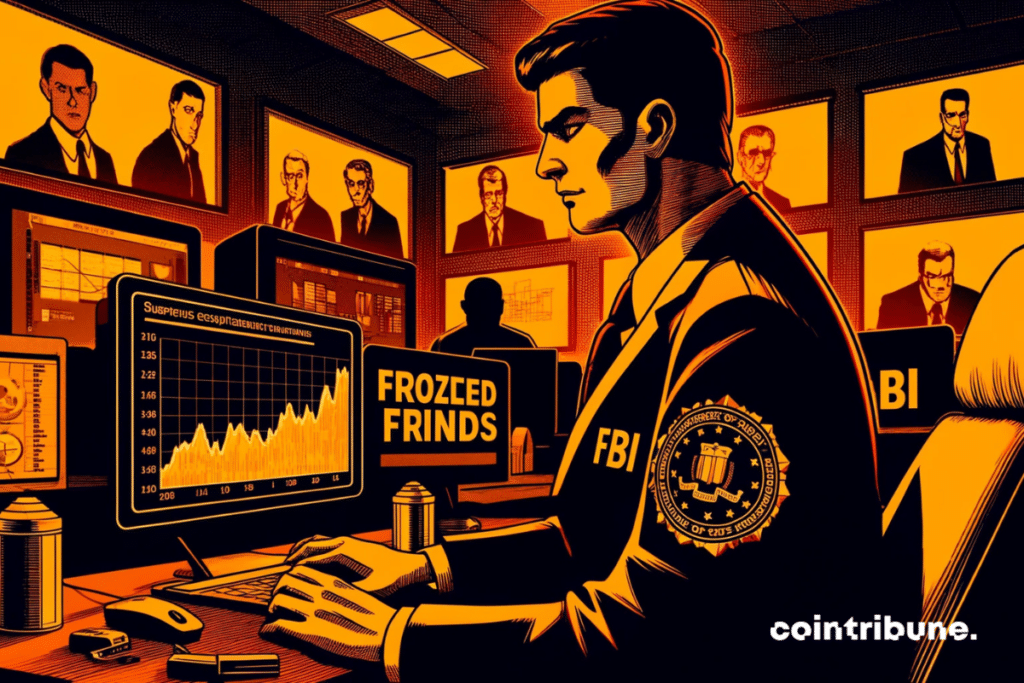
Une traque numérique : comment les autorités ont démantelé le réseau
Contrairement aux idées reçues, c’est la transparence inhérente à la blockchain qui a permis cette saisie. Les portefeuilles crypto utilisés par le Hamas — au moins 17 identifiés — ont laissé des traces indélébiles.
Les transactions, bien que fragmentées via des échanges et des courtiers de gré à gré, ont formé une mosaïque retraçable. « Les adresses de collecte étaient disséminées, mais interconnectées », précise le communiqué du DOJ. Une ironie : la technologie critiquée pour son anonymat relatif a ici servi de fil d’Ariane.
L’affaire prend une tournure géopolitique avec l’implication de Binance. Déjà sous le feu des critiques pour ses lacunes en matière de lutte anti-blanchiment, la plateforme est accusée d’avoir facilité, même indirectement, ces flux financiers.
En janvier 2024, des familles de victimes ont intenté un procès contre l’exchange, soulignant un paradoxe : comment un géant du secteur a-t-il pu ignorer des transactions liées à des entités sanctionnées ? La réponse réside peut-être dans les failles d’un système encore en maturation.
Blanchiment 2.0 : une efficacité limitée
Si 1,5 million de dollars auraient été blanchis depuis octobre 2023, ces chiffres masquent une réalité moins médiatique.
Les méthodes traditionnelles — transferts hawala, cash physique — restent dominantes pour le terrorisme. La crypto, elle, impose des risques élevés : chaque transaction est une empreinte.
Un rapport Chainalysis (2023) le confirme : moins de 1 % des activités illégales liées à la crypto concernent le financement terroriste. Preuve que les groupes armés préfèrent encore l’opacité des canaux classiques.
Cette saisie spectaculaire relance donc un débat ancien : faut-il surréguler un outil marginalement utilisé par les terroristes, au risque d’étouffer l’innovation ?
Régulation crypto : entre paranoïa et pragmatisme
Depuis 2019, le Hamas testerait les dons en crypto. Pourtant, le Congressional Research Service (décembre 2024) souligne le manque de preuves sur « l’échelle et l’efficacité » de ces campagnes.
Alors pourquoi cet acharnement législatif ? Certains y voient une stratégie pour justifier un contrôle accru sur un secteur perçu comme ingouvernable.
Pourtant, les outils existent déjà : l’OFAC sanctionne régulièrement des adresses suspectes, comme en janvier 2024 avec le Royaume-Uni et l’Australie.
Le règlement de 4,3 milliards de dollars avec le DOJ en novembre 2023 montre que les autorités savent frapper fort. Mais cela suffit-il ? Les poursuites contre Changpeng Zhao, ex-PDG de Binance, révèlent une volonté d’établir un précédent juridique. Reste que criminaliser les plateformes pour les agissements de leurs utilisateurs pose une question éthique : jusqu’où responsabiliser les intermédiaires techniques ?
Plutôt que de surtransposer les lois bancaires, ne faudrait-il pas adapter la régulation aux spécificités de la blockchain ? La traçabilité des actifs numériques offre une opportunité unique de surveiller les flux sans étouffer l’industrie.
Les stablecoins, par exemple, pourraient être encadrés via des protocoles de vérification en temps réel. Une piste bien plus prometteuse que les interdictions brutales, souvent contournées.
La saisie de 200 000 $ en crypto liées au Hamas est moins un aveu de faiblesse qu’une démonstration de force technologique.
Elle rappelle que la blockchain, loin d’être un sanctuaire pour criminels, est un outil à double tranchant. Alors que les États-Unis affûtent leurs armes légales, l’enjeu sera d’éviter un réflexe sécuritaire contre-productif. Car réguler sans comprendre, c’est risquer de tarir l’innovation pour traquer des fantômes. Découvrez, par ailleurs, le plan secret de Saylor pour les USA.
Maximisez votre expérience Cointribune avec notre programme 'Read to Earn' ! Pour chaque article que vous lisez, gagnez des points et accédez à des récompenses exclusives. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à cumuler des avantages.

Fasciné par le bitcoin depuis 2017, Evariste n'a cessé de se documenter sur le sujet. Si son premier intérêt s'est porté sur le trading, il essaie désormais activement d’appréhender toutes les avancées centrées sur les cryptomonnaies. En tant que rédacteur, il aspire à fournir en permanence un travail de haute qualité qui reflète l'état du secteur dans son ensemble.
Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.